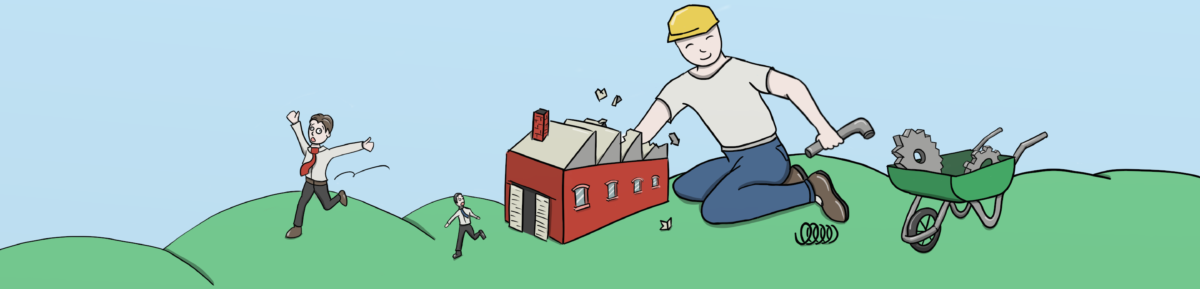Introduction
Les livres et les thèses : que de vertueux supports pour transmettre la connaissance ! Mais attention, encore faut-il, une fois de plus, être parfaitement conscient, à tout instant de la lecture, du contexte dans lequel le document a été écrit. Il faut tout considérer : la localisation temporelle et géographique, le milieu culturel, les objectifs de l’auteur, etc. Sans ça, le risque est grand de considérer le contenu comme étant universel et intemporel. Vous noterez que la documentation est bien liée à l’histoire. C’est bien souvent elle qui permet de la transmettre par les livres et tout autre support, aujourd’hui éventuellement numérique.
L’exemple du gazogène.
Dans le contexte des loisirs techniques, une machine très répandue est, apparement, la victime parfaite de la non recontextualisation, probablement engendrée par la documentation et le mimétisme technologique. Il s’agit du gazogène. Le mot “gazogène” dans la catégorie “images” d’un moteur de recherche démontre immédiatement la circulation indéniable de plans périmés de bientôt 100 ans. On regrette l’absence de plans de gazogène “high tech”.
Le gazogène est une machine inventée en 1920 par George Imbert qui permet de créer un gaz inflammable à partir d’un combustible solide, notamment bois ou charbon. Il fut utilisé pendant la seconde guerre mondiale par la population civile, lorsque le pétrole vint à manquer, pour faire fonctionner les véhicules. Il est actuellement toujours utilisé en Corée du nord du fait de l’embargo sur le pétrole.
Malheureusement, la grande communauté mondiale de bricoleurs de gazogènes ne parvient pas à produire d’améliorations “poussées” autres qu’esthétiques sur les véhicules équipés de ce système.
On peut effectivement constater, sur les forums de passionnés de gazogène, et dans leurs vidéos visibles sur le net, que les plans ancestraux des années 20 circulent encore massivement ! Après tout « un gazogène c’est comme ça qu’on le fait, non ? » Puisque c’est écrit sur les plans …
L’utilisation d’un gazogène ancien est laborieuse et souvent critiquée, à juste titre, à cause de ses principaux défauts, à savoir :
- Le ralenti moteur doit être très élevé pour maintenir la production régulière de gaz.
- Le démarrage du gazogène est long et laborieux (allumage manuel, attente à l’extérieur du véhicule, etc.)
- La gestion de la richesse du mélange air/gaz est, elle aussi laborieuse, elle se fait à la main avec un petit levier que l’on doit souvent manœuvrer dans l’habitacle.
- Etc.
Il est parfaitement regrettable d’entendre ces phrases comme étant des fatalités imputables au gazogène, à l’ère où l’on envoie des rovers sur Mars réalisant des analyses automatiquement tout en nous les transmettant à des distances intersidérales. Ces défauts du gazogène sont ceux d’une conception brute et primitive d’un temps où il n’y avait ni électronique, ni moyen d’acquérir des composants technologiques peu coûteux qui permettraient d’éliminer ces défauts.
Il serait appréciable d’entendre par exemple :
- pour régulariser le ralenti moteur, nous pouvons stocker le gaz sur le court terme avec une turbine centrifuge entraînée par le moteur et alimentant un réservoir tampon
- l’automatisation du démarrage peut se faire avec quelques capteurs, et actionneurs divers
- la gestion de la richesse peut se faire automatiquement avec des servo-vannes après avoir étudié sur un prototype instrumenté, le comportement du moteur+gazogène
- etc.
Les automaticiens et techniciens qui liront cette partie auront déjà, j’en suis sûr, en prenant rapidement connaissance du fonctionnement d’un gazogène, beaucoup d’idées pour actualiser ce procédé ! S’il ne l’a pas été jusqu’à maintenant, c’est parce que le gazogène (en locomotion) est très exclu du contexte économico-industriel, en raison de l’utilisation massive du pétrole. Ainsi, aucun investissement en très hautes technologies et matière grise n’a été affecté à la problématique du gazogène pour véhicule.
Conclusion
La documentation photographie l’histoire et incite les personnes à copier les systèmes contenus dans les livres sans les décontextualiser/recontextualiser. Nous devons être conscients des différences contextuelles historiques qui ont été la cause de la constitution des machines ainsi dessinées dans les livres. On peut aussi se poser la question de savoir s’il n’existe pas un mimétisme dans la manière de structurer les livres et documents qui traitent des mêmes sujets.